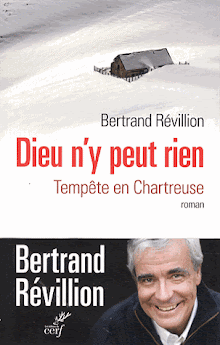Nous voici, une fois encore, au bord de la cendre...
Le feu a soufflé ses braises.
L’obscurité des jours, soudain nous marque au front.
Le sable du désert est gris et froid comme un tison.
Les marches de nos escaliers, voici qu’elles se creusent sous le poids et l’usure des heures sans aurore..
L’hiver, sans crier « gare ! », s’est attardé.
Un vent glacé qui passe sous le seuil de nos âmes pour mieux les engourdir.
Et l’Eglise qui veut nous réchauffer, n’a rien trouvé de mieux qu’un mince soleil de cendre au-dessus de nos yeux !
Nous qui, aux instants de fragiles espérances, nous prenions pour des filles ou des fils de Roi, nous voici soudain comme réduit en poussière.
Mais quel est donc ce Dieu qui nous tire vers le haut et qui, du même mouvement, nous rappelle nos tombeaux. ?
La cendre est comme le sang au linteau de l’Exode, comme les miettes éparses d’un pain sans sel ni levain, comme une herbe amer, un rameau calciné qui déjà nous annoncent notre marche au désert.
Le sable est comme un lac où se mire le « dès-être ».
En lisière du regard la cendre implacable, nous dévoile tous nos aveuglements.
Brûlure d’un feu éteint, blessure vive au fronton d’un visage si peu transfiguré.
Icône calcinée de l’éternelle Présence, victime de tous nos incendies.
Et le psalmiste implore, et il nous faut l’entendre malgré nos surdités :
« Sur ton serviteur, que s’illumine Ta face ». (1)
Carême ? Saisissante découverte que la demeure est vide, ou si peu habitée. Dieu en nous, mais nous tellement hors de nous !
Carême ? Notre foi qui vacille comme un château de cendres, une croix consumée qui s’abat comme un arbre.
Carême ? Instant de vérité où le désir en nous, soudain, mesure ses fatigues.
Et nous voici, traînant nos pauvres incroyances.
Dieu qui se fait lointain et vers qui, pourtant, il est temps maintenant, sans crainte, de marcher.
Car « quiconque marche dans les ténèbres sans voir aucune lueur, qu’il se confie dans le nom du Seigneur, qu’il s’appuie sur son Dieu. » (2).
Quarante jours de feu pour oser avouer que le « je » est fragile, qu’il a besoin d’un « Autre » pour se mettre à genoux, la seule et belle posture qui le mènera debout.
Quarante jours pour avoir faim et soif de l’indicible force qui, au matin de Pâques, viendra fendre la mort.
L’Apôtre qui tomba et perdit pour un temps le regard, se fît plus tard prophète et visionnaire : « La puissance se déploie dans la faiblesse » (3).
Ce qu’au fond de son cloître une humble carmélite sût cueillir en son cœur comme une brassée de roses :« Plus on est faible, sans désirs ni vertus, plus on est propre aux opérations de cet Amour consumant et transformant » (4).
Croire, contre toute logique, que la braise et le feu peuvent naître de la cendre.
Marcher résolument, joyeusement vers les aridités fécondes d’un Carême intérieur avec cette certitude en forme de promesse : « Jésus viendra nous chercher, si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d’amour » (5).
1) Psaume 30, 17
2) Isaïe 50,10
3) 2 Co 12, 9
4) Thérèse de Lisieux, lettre 197
5) Id.
13.3.11
8.3.11
G.P.S. pour temps de Carême
« Ecouter ce que les eaux vives
de notre désir
ont à nous révéler
de notre soif intime. »
Prendre, entre ses doigts, un peu de cendre sur la margelle d’une cheminée encore frémissante ; sentir la tiédeur de la suie, ne pas craindre de se salir, se signer doucement comme on marque d’huile sainte le front d’un baptisé, laisser, comme un onguent, la trace sableuse du feu endormi pénétrer la peau, au plus profond…
On dit que les mystiques – qui sont aussi poètes ! – croient que la cendre est le meilleur des baumes sur les brûlures de l’âme…
Agripper l’échelle de meunier qui grimpe jusqu’au grenier de notre cœur, refermer un instant la trappe sur la rumeur du monde, demeurer seul, entre ciel et terre, laisser l’assourdissant silence de la divine présence prendre possession peu à peu de l’espace. Ouvrir le vasistas sur un carré d’azur, humer l’air frais, respirer la brise légère, souffle imperceptible de l’Esprit qui plane sur nos vies….
On dit que les mystiques – qui sont aussi poètes ! – croient que la vie spirituelle consiste, à chaque seconde, à inspirer à plein poumon le grand vent de la Parole…
S’arrêter de courir, oser s’asseoir au seuil du puits de notre propre désir. Ecouter ce que ses eaux vives ont à nous révéler de notre soif intime. Décider de ne rien décider, laisser notre fragile existence se laisser porter par les courants éternels. Se laisser enfin guider par Celui qui, seul, connaît le cap. Ne plus s’appartenir, tenter de se poser – et de se reposer – entre Ses mains…
On dit que les mystiques – qui sont aussi poètes – croient que pour croire il suffit juste de laisser la terre ocre de nos vies s’imbiber de cette eau vive dont le grand Potier se serre pour, de ses mains douces et rugueuses, nous façonner comme un vase d’argile…
Marcher vers la montagne et ses sentes oubliées ; s’écorcher les mains, le cœur et l’âme à la roche des passages difficiles, pleurer ce qu’il y a à pleurer, vider la rancune, assécher les regrets pour laisser place à l’indicible espérance, oser franchir le col escarpé du grand pardon et, tout à coup, devant l’infini beauté de la création, rendre grâce et chanter la joie de croire, plus forte que l’épaisse suie qui, si souvent, nous aveugle !
Les mystiques – qui sont aussi poètes ! – n’arrivent pas à ne pas croire depuis des millénaires, que, sous la cendre la plus noire et la plus froide, le feu couve et demeure, le grand feu, l’immense brasier qui dévore les madriers mal équarris de nos croix.
« J’aime les mystiques, dit Dieu, qui croient, envers et contre tout, à l’incroyable aube ténue du grand matin Pâques ! J’aime leurs yeux de poètes, dit Dieu, qui, au travers des troncs calcinés des blessures humaines, devinent déjà les buissons ardents du grand printemps de l’Esprit ! »
Inscription à :
Articles (Atom)